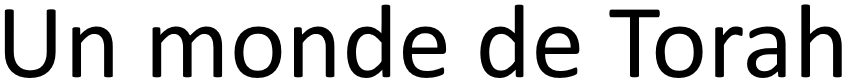PARACHAT KÉDOCHIM 2022
Il est écrit dans notre Paracha : « Ohéakh Tokhiakh Ète Amitékha » (Tu réprimanderas ton prochain) (Vayikra 19 ; 17)
Nous avons comme règle que toutes les particules את, (Ète) et גם (Gam) viennent ajouter un nouvel enseignement. Car en général on aurait pu se passer de ces deux mots, on aurait tout de même compris le sens de la phrase. Quel est donc l’enseignement ajouté par le mot « Ète » dans ce Passouk ?
Rav Israël Sanlanter explique que le « Ète » vient ajouter que l’Homme doit également se réprimander lui-même : « Ète », y compris toi-même ! En effet, on doit être assez honnête pour se corriger soi-même de ses fautes !
Le Ben Ich Haï illustre cet enseignement par une parabole. Un homme fut condamné pour vol par le roi à la peine capitale. Avant que ne soit exécutée la sentence, le coupable demanda à prendre la parole. Il expliqua qu’il détenait un savoir particulier que personne d’autre au monde ne connaissait, et qu’il voulait le transmettre avant de mourir, afin que le monde continue à en jouir.
Le Roi, curieux, demanda de quel savoir il s’agissait. Le voleur expliqua qu’il savait comment planter une graine dans la terre afin qu’elle donne des fruits en trente minutes seulement ! Le Roi curieux et intéressé accéda à sa requête et ordonna de lui donner ce qu’il réclamait pour enseigner sa science.
L’homme mélangea de l’eau avec certaines herbes très spéciales, puis planta la graine. A ce moment, il se tourna vers le Roi et lui dit : Ma préparation est prête, il ne reste qu’à arroser la plante avec mon mélange. Mais la condition indispensable à la réussite de l’opération est que les mains qui versent ce mélange soient propres et exemptes de tout vol.
Je demande donc au Premier Ministre de venir verser le mélange. Ce dernier refusa, arguant qu’étant enfant, il avait volé quelques friandises à l’épicerie.
Le voleur proposa donc au ministre des Finances, qui, confus, s’exempta également prétextant que vu son poste, il se peut qu’il ait involontairement détourné quelques deniers, et qu’il ne fallait prendre aucun risque quant à la réussite de l’opération.
En dernier recours, notre homme se tourna vers le roi et lui demanda de venir, lui-même, verser ce mélange. Mais, le roi expliqua qu’étant jeune, il avait volé quelques diamants de son père, le défunt roi.
Alors le voleur s’exclama : Vous avez tous volé, et vous me condamnez à mort alors que j’ai volé quelques miches de pain pour manger ?
Le roi, honteux, comprit le subterfuge et le gracia.
La morale de cette histoire est facile à comprendre, réfléchissons sur notre propre comportement avant d’aller critiquer l’autre.
S’il est vrai que la Torah nous demande de réprimander notre prochain, mais tout de suite après dans le Passouk suivant il est écrit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Vayikra 19 ; 18)
Parfois, on voit quelqu’un se dépêcher de ramasser un Sidour tombé par terre. C’est le signe d’une belle sensibilité aux Mitsvot.
Mais pourquoi, lorsqu’un autre juif tombe durant des moments difficiles de la vie, les gens ne vont pas courir afin de le ramasser et le protéger d’être dévasté ?
Après tout, un juif est comparé à un Séfer Torah tout entier et pas uniquement à un Sidour.
Rav Lévi Yitshak de Berditchev explique que de même que notre amour pour nous-même n’est pas dépendant de qualités particulières, nous nous aimons malgré nos défauts que nous connaissons très bien ; de même doit-il en être pour notre amour avec notre prochain. Un juif doit être aimé uniquement pour le fait qu’il est également juif. Nos défauts ne diminuent pas l’amour que nous nous portons, et il doit en être de même avec un autre juif.
Rabbi Yaakov Yitshak de Pchisha disait qu’on peut accorder plus de valeur à l’une des parties de notre corps plutôt qu’à une autre, ainsi on peut penser que notre cœur a plus de valeur que notre main et que nos yeux en ont plus que nos pieds. Néanmoins, nous faisons extrêmement attention à ce qu’aucune partie de nous-même ne soit blessée.
Il doit en être de même de notre prochain. Même la personne que nous estimons le moins a droit au plus grand respect.
Bien que notre cœur ou nos yeux nous paraissent plus importants que nos orteils ou nos doigts, nous sommes extrêmement vigilants en ce qui concerne la bonne santé de ces derniers.
Aimer son prochain comme soi-même signifie accorder au plus insignifiant des hommes le même respect que celui que l’on accorde à la partie la plus insignifiante de soi- même.
Il est écrit dans les Pirké Avot : Yéhochoua Ben Péra’hya dit : « Fais-toi un maître ; acquiert-toi un compagnon d’étude et juge tout homme du bon côté. »
Cela signifie que lorsqu’on voit quelqu’un en train de réaliser un acte qui n’est pas clair, un acte qu’on peut interpréter comme une véritable transgression, mais qu’on peut aussi interpréter comme un acte permis que la personne réalise pour une quelconque raison, nous avons le devoir dans un tel cas de porter un regard positif sur cet acte, et penser en nous même que cette personne n’a pas transgressé un interdit.
À ce propos, Rav Chalom Schwadron raconta l’histoire suivante :
À l’époque de la 1ère guerre mondiale, régnait à Jérusalem une misère effroyable. Des hommes et des femmes mourraient littéralement de faim.
Chacun faisait tout ce qui était en son possible pour obtenir un morceau de pain.
Un œuf était considéré en ces temps comme un véritable trésor.
Avant que la guerre n’éclate, un juif de Jérusalem avait économisé durant plusieurs années sous après sous, jusqu’à obtenir un « Napoléon » en or.
Cette pièce très rare allait lui procurer la subsistance, à lui et à sa famille pendant une longue période.
Il plaça le Napoléon chez lui au-dessus d’une haute armoire, en se disant : « Lorsque des jours difficiles viendront, j’échangerai cette pièce et j’achèterai de la nourriture pour mon foyer. »
Un jour, le jeune enfant de ce juif sauta en s’amusant dans la maison, et à sa surprise, il vit le Napoléon qui brillait au-dessus de l’armoire. Il prit la pièce et se rendit rapidement dans un magasin pour y acheter des gâteaux.
En chemin, un homme, véritablement affamé, vit le jeune enfant marcher avec un Napoléon à la main.
Cet homme se dit : « Il existe encore des gens riches à Jérusalem ? Comment peut-on confier à un jeune enfant une telle pièce dans les mains ? »
Son ventre le faisait tellement souffrir à cause de la faim qu’une mauvaise pensée lui vint à l’esprit. Il s’approcha de l’enfant et lui dit :
« Petit ! Qu’as-tu dans les mains ? »
L’enfant lui montra la pièce.
L’homme lui dit : « Viens, je vais te donner une pièce d’une plus grande valeur ! »
L’homme prit une simple pièce en cuivre et la donna à l’enfant, en échange du Napoléon.
L’enfant poursuivit son chemin vers le magasin. Il donna la pièce au commerçant et reçu en échange quelques gâteaux.
Quelques heures plus tard, le père de l’enfant, propriétaire du Napoléon, constata que sa précieuse pièce avait disparue ! Il commença à retourner toute la maison afin de la retrouver. Il chercha encore et encore, mais il ne trouva aucune pièce.
Soudain, l’enfant dit à son père : « Papa ! J’ai pris la pièce et je suis allé au magasin pour y acheter des gâteaux, car j’avais faim ! » (L’incident qui s’était produit en chemin avait disparu de la mémoire du jeune enfant).
Le père prit l’enfant et se rendit avec hâte au magasin. Il s’approcha du patron avec colère en lui disant : « Mon fils est venu ici avec un Napoléon en or, et tu n’as pas eu honte d’exploiter sa naïveté ! Tu lui as volé la pièce en échange de quelques gâteaux ! »
Le commerçant répondit : « Rien de tout cela ne s’est produit ! Ton fils est effectivement venu ici, mais il n’avait aucune pièce en or dans les mains, si ce n’est qu’une misérable pièce en cuivre. »
Le père poursuivit le commerçant dans un Din Torah devant l’un des Grands Rabbanim de Jérusalem.
Le Rav écouta les arguments des deux parties, et trancha que le commerçant ne devait rien rembourser.
Cependant, puisqu’en définitif il était poursuivi en justice, et qu’il reconnaissait partiellement ce qui s’était passé (que l’enfant s’était effectivement rendu à son magasin mais avec une pièce en cuivre et non en or), le commerçant fut condamné seulement à un serment que les choses se sont réellement passées tel qu’il le dit, que l’enfant ne s’est présenté qu’avec une pièce en cuivre.
Le commerçant qui était un juif craignant Hachem et sincère, répondit que de sa vie il n’avait jamais prêté serment, et qu’il n’était pas disposé à le faire présentement.
Il préféra rembourser l’intégralité de la valeur du Napoléon. Et c’est ce qu’il fit.
L’histoire commença à se répandre parmi les habitants de Jérusalem, et beaucoup racontaient : « Avez-vous entendu ? Cet impie de commerçant a exploité la naïveté d’un enfant et lui a volé un Napoléon en or ! »
Ainsi, le bon renom de ce commerçant commença à flétrir, au point où tout le monde le considéra comme un voleur, et on boycotta son magasin.
Les choses en arrivèrent à un tel degré que le commerçant annonça sa mise en faillite et ferma son magasin. Il n’avait plus de subsistance.
Le temps passa, la guerre mondiale s’acheva et la situation économique des habitants de Jérusalem s’améliora.
Même l’homme affamé qui avait escroqué l’enfant en lui prenant le Napoléon en échange d’une pièce en cuivre, vit sa situation s’améliorer et il décida de rendre l’objet du vol.
Il se rendit chez le père de l’enfant et lui dit :
« Au temps de la guerre, nous étions, moi et ma famille, affamés sans le moindre morceau de pain. Un jour, je vis ton fils qui marchait dans la rue comme un grand riche avec un Napoléon en or dans les mains. Je me suis dit que si tu étais si riche, tu serais certainement d’accord à ce que je t’emprunte temporairement la précieuse pièce. J’ai donc donné à ton fils une pièce en cuivre, et j’ai pris le Napoléon pour moi. A présent, je viens pour te rendre le Napoléon. »
Le commerçant avait dit la vérité ! Le père de l’enfant couru chez celui qu’il avait soupçonné à tort, le supplia de lui pardonner et lui rendit toute la somme du Napoléon qu’il avait préféré payer plutôt que de jurer.
L’un des Grands Guéonim de Jérusalem entendit cette histoire, et réagit :
« Réfléchissons ! Lorsque cet acte sera jugé dans le Ciel, qu’est-ce qu’on dira ?
Qui va-t-on juger ? Le père de l’enfant ? Il n’est coupable de rien, il s’est fié à son enfant qui ne lui a pas parlé de la substitution du Napoléon par la pièce en cuivre.
Le commerçant ? Il s’est comporté avec une correction exceptionnelle, il n’a commis aucune faute.
L’homme affamé qui a volé le Napoléon ? Il était si affamé qu’il n’avait pas le moindre morceau de pain, et il est dit : « On ne méprise pas le voleur qui commet un larcin pour assouvir sa faim. » (Michlé 6-30).
Qui reste-t-il alors ?
Tous les gens qui ont parlé contre le commerçant. Ils n’étaient pas concernés mais ils se sont quand même hâtés de le juger négativement, au point de lui causer un énorme dégât, en le faisant souffrir et en le poussant à la faillite. Ce sont eux qui subiront toute la rigueur du châtiment pour leurs actes ! »