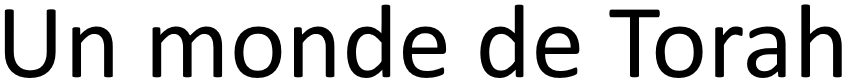LA NUDITÉ
Il est écrit dans la Genèse (2 ; 25) : « Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient nus et ils n’éprouvaient aucune honte. »
Après avoir mangé du fruit défendu, l’homme a intégré en lui la matière, elle fait à présent partie de lui et donc ses instincts se réveillent. Il sent qu’il est nu et la nudité génère chez l’homme des passions, il a donc besoin d’un habit pour couvrir sa nudité et calmer ses envies.
Plus profond est le sommeil, moins le monde extérieur peut nous influencer. Dès le réveil, la perception intervient. La peau constitue le principal appareil sensoriel, l’organe du toucher. L’homme perçoit les impressions grâce à elle. Pendant le sommeil, l’âme humaine se replie pour ainsi dire de la périphérie vers l’intérieur, et dès que l’homme se réveille, elle regagne en quelque sorte son poste avancé : la peau. Cette pensée est tellement ancrée dans la langue hébraïque que si quelqu’un s’évanouit on dira que son esprit se voile, se replie. Chez l’homme alerte, par contre, l’esprit est présent jusqu’au bout de ses ongles. L’homme dont la perception repose uniquement sur son sens du toucher, qui n’a accès au monde visible qu’à travers le sens du toucher, s’appelle en hébreu, « l’homme peau », l’aveugle.
La honte est le sentiment de celui qui est déçu de lui-même. Lorsque quelqu’un ne parvient pas à remplir son rôle, trouve qu’il n’est pas tel qu’il devrait être, alors il a honte. D. a fait un don incomparable à l’homme – tout en sachant bien que souvent, celui-ci ne serait pas à même de satisfaire à sa destinée – en lui implantant ce sentiment qui s’empare de lui dès qu’il prend conscience de son insuffisance. Grâce à ce don, il devient ainsi son propre tuteur et son propre gardien. La timidité et la modestie ne sont d’ailleurs rien d’autre que la prise de conscience du fait qu’on est encore loin du but que l’on s’est fixé pour soi-même. Ainsi, Dieu a livré l’homme à lui-même et lui a donné un idéal auquel il doit se conformer. La conscience représente l’intuition de cet idéal, la honte étant le verdict de la conscience.
La condition originelle du premier couple humain nous est donc décrite dans cette courte phrase : tous les deux, l’homme et sa femme, était nus et n’éprouvaient aucune honte. Ils n’avaient pas à avoir honte, ne devaient pas avoir honte. Tant que tous les deux, l’homme et la femme, formaient un même corps au service d’un même esprit et étaient soumis au D. unique, et tant qu’ils se conformaient, corps et âmes, à l’idéal humain de la ressemblance à D., leur corps et leur esprit étaient purs et saints, tant du point de vue spirituel que matériel, ils leur étaient donnés par D. en vue de la réalisation de la vocation humaine.
L’homme peut suivre autant ses aspirations spirituelles que matérielles. Tant qu’il ne sort pas du cadre consacré par D. et qu’il ne s’en sert que pour appliquer les préceptes divins, il n’a pas à avoir honte ni de ses aspirations spirituelles, ni de ses aspirations matérielles. Un corps humain pur, un monde physique respectueux de la morale, n’est pas moins saint que le monde de l’esprit. La grandeur morale de l’homme requise par la loi divine est avant tout basée sur cette sanctification de l’homme physique, de telle sorte que nous puissions vaquer également à la satisfaction de nos penchants les plus charnels à l’intérieur du cadre divin, et que nous n’ayons pas avoir honte de notre corps animal, de notre nudité.
Dès lors que l’homme laisse cependant tout loisir à sa sensualité, dès qu’il cesse d’élever, grâce à son énergie morale, le physique dans le cadre du divin, et qu’au contraire il abaisse ce qu’il y a de divin en lui, au moyen de son sensualisme, dans le cercle du matériel, aussitôt il devient honteux de sa nudité. Ce sentiment de honte est le gardien de la moralité. Il représente la voix divine exhortant l’homme déchu de son élévation morale à maîtriser son corps physique, à en rester le maître, et à s’élever ainsi, corps et âme, librement respectueux de la morale, à la hauteur de sa vocation divine.
Tant que la sensualité n’avait pas fait déchoir l’homme de cette libre et pure élévation, ils pouvaient tous les deux être nus sans aucune raison d’avoir honte de leur nudité.
L’accentuation expresse du verset : tous les deux, l’homme et sa femme, était nus, et n’avaient pas à en avoir honte, est significative. C’est une profonde vérité qui est consignée ici : non seulement du point de vue spirituel, mais également du point de vue physique, tous les deux, l’homme et la femme, se doivent d’être pareillement purs, pareillement respectueux de la morale, pareillement saints. Tant que les deux sexes n’aspirent pas avec le même sérieux à l’acquisition des vertus essentielles, tant que les adolescents et les hommes professent qu’il leur est permis ce qu’on ne tolère pas chez les jeunes filles ou chez les femmes, l’espèce humaine est malade. D. exige de l’homme la même innocence, la même pureté morale que de la femme.
L’opposition à l’animal représente la pierre de touche de la moralité humaine. C’est la sagesse animale qui détourna le premier homme de son devoir ; c’est cette même sagesse animale qui est, aujourd’hui encore, l’instigatrice de tout péché. L’histoire du premier faux pas de l’humanité préfigure l’histoire de tous les égarements. L’instinct de l’animal est inné en lui, et cet instinct représente la voix de D. en lui, la volonté divine à son égard. Par conséquent, tout ce qu’il fait conformément à cette impulsion divine qui le domine – il ne fait d’ailleurs rien d’autre, ne peut rien faire d’autre – est bon, et tout ce dont cet instinct le prévient, est mauvais.
L’animal ne peut s’égarer, il ne peut suivre que sa nature, il doit s’y plier.
Il n’en va pas de même pour l’homme. L’homme est appelé à prendre parti pour le bien, librement et avec une parfaite conscience de son devoir, et à fuir le mal. Il doit néanmoins aussi satisfaire aux exigences de sa nature sensuelle, non pas par sensualité, mais par sens du devoir. Même son plaisir le plus sensuel doit être un acte moral ; jamais, nulle part, sous aucun rapport, il ne doit être animal.
Voilà pourquoi il porte en lui à la fois le matériel et le spirituel. Le bien s’opposera ainsi souvent à sa sensualité, et le mal lui paraîtra souvent attrayant ; ceci afin qu’il pratique le bien et s’abstienne du mal malgré sa sensualité, en vertu de sa haute vocation divine, avec la libre énergie de sa nature divine. Voilà pourquoi la voix divine ne parle pas « en lui », mais s’adresse à lui, pour lui indiquer ce qui est bien ou mal. Cette voix divine qui s’adresse à l’homme se heurte cependant à l’opposition de sa sensualité ; celle-ci se manifeste en lui dès qu’il la laisse s’exprimer, c’est-à-dire dès qu’elle n’est plus sous l’emprise ou la conduite de sa nature divine. La voix divine insufflée à l’homme – la conscience, dont la honte est le messager – ne fait qu’exhorter l’homme à être bon et à fuir le mal.
Ce qu’il doit considérer comme bien ou comme mal, l’homme ne peut cependant l’apprendre que de la bouche même de D.. L’animal ne peut développer que sa nature sensuelle, et son entendement est au service de cette nature ; mais l’homme a été placé sur terre au service de D. et de Son monde, et non pas afin d’assouvir sa nature sensuelle au moyen des délices mis à sa disposition. Ce service représente son devoir, et ce n’est que pour les besoins de ce service que la jouissance lui fut permise.
L’animal n’est là que pour lui-même. L’homme, par contre, est là pour D. et pour le monde, et est appelé à sacrifier joyeusement sa nature individuelle à cette vocation supérieure. Pour l’animal, même le plus intelligent d’entre eux, il est inconcevable que l’homme passe froidement à côté des jouissances les plus belles et les plus désirables.
L’homme doit mettre l’accent sur le fait que l’interdiction divine est la raison de son abstinence. Bien sûr on pourrait s’interroger : « Et même si D. l’a dit ! Est-ce une raison pour obéir ? L’instinct n’est-il pas aussi une voix divine ? Si cette jouissance est mauvaise pour l’homme, pourquoi D. l’a-t-il rendue attrayante et nous en a-t-il inspiré le désir ? N’est-ce pas là une façon de nous dire clairement que l’un est fait pour l’autre ? Cette voix divine en nous n’est-elle pas Sa voix la première et la plus claire ? D. a d’abord créé les plaisirs et nous a créés avec le désir d’en jouir, et ensuite Il nous l’interdirait ? »
C’est ainsi que s’exprime, aujourd’hui encore, la sagesse animale, qu’elle soit nue ou sous le couvert de la philosophie, là où une interdiction divine nous tient expressément à l’égard d’une jouissance sensuelle trop séduisante. Aujourd’hui comme alors, elle dramatise, néglige l’ensemble de ce qui est moralement permis à cause de quelques interdits et présente la divine loi morale comme opposée à toute jouissance sensuelle.
La réponse est encore innocente : tout ne nous est nullement interdit, au contraire, la même voix qui nous a permis de jouir abondamment de tous les délices du monde, nous en a défendu quelques-uns. La soumission de notre nature sensuelle à la volonté divine est la condition de toute moralité, une condition inséparable de la haute position morale de l’homme et de son unique vocation.
La liberté morale, ce garant fondamental de la grandeur humaine, est elle-même inconcevable sans la possibilité de pécher ; et la possibilité de pécher suppose inévitablement que le mal exerce un attrait sur nos sens et que le bien leur paraisse inacceptable. S’il n’en était pas ainsi, le choix du bien et l’abstention du mal seraient, même chez l’homme, affaire d’instinct, et alors l’homme ne serait pas homme.
C’est à travers la maîtrise de ses inclinaisons sensuelles et la soumission de sa nature sensuelle à la volonté divine que l’homme devient homme, et c’est dans cette mise en pratique que réside le premier problème de l’éducation humaine.
Aujourd’hui encore, confronté aux exigences de la loi divine, chacun d’entre nous doit se décider à suivre : soit la voix de la sensualité, la fantaisie de la raison matérialiste et la sagesse de la vie animale instinctive, soit la voix de son D. en étant pleinement conscient de sa vocation supérieure.
Après la faute originelle, l’homme reçoit le vêtement des mains de D., dernier don du temps de sa vie au paradis. L’animal vit nu, il n’a pas de vêtement. En couvrant sa nudité, le vêtement rappelle à l’homme la supériorité de la vocation humaine par rapport à celle de l’animal, un rappel devenu d’autant plus utile que l’esprit est lui-même maintenant au service des besoins du corps.
C’est comme si D. s’adressait à nous : « Ton vêtement te dit que tu es un homme et que tu ne dois pas laisser l’animal prendre le dessus sur toi ; il te dit que le monde qui t’environne n’est pas encore, malgré toutes les découvertes, redevenu le paradis. »